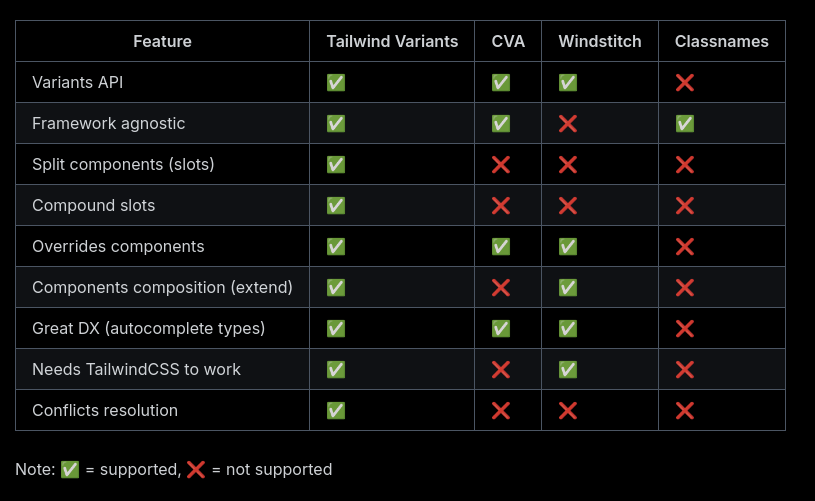Claude Sonnet
Différentes version de Claude Sonnet :
Journaux liées à cette note :
Comment j'ai perdu ma discipline en décembre et janvier
Jusqu'à mi-décembre 2025, cela faisait environ 2 ans que j'arrivais à rester concentré sur un sujet à la fois. J'avais réussi à éviter de papillonner d'un sujet à l'autre. Pour moi, un sujet n'est vraiment terminé que lorsque j'ai publié la note correspondante.
Le dernier sujet que j'avais exploré avec succès était mon étude de Fedora CoreOS.
Je me suis ensuite lancé dans l'étude pratique approfondie de Podman Quadlets. J'ai réussi à publier coreos-quadlet-playground, mais avant même d'avoir commencé à rédiger ma note de synthèse, j'ai perdu ma discipline.
Dans cette note, je vais tenter d'expliquer comment et pourquoi j'ai "dérapé" et faire un bilan des side-projects sur lesquels j'ai papillonné pendant ces deux derniers mois (depuis mi-décembre).
Lors de mon travail sur Podman Quadlets, j'ai découvert comment ce projet utilise avec élégance systemd-run et le mécanisme des generators (systemd-run-generator) de systemd pour incarner la philosophie Unix.
Suite à cette découverte, j'ai repensé aux scripts manuels que j'utilisais ces derniers mois pour lancer mes VM QEMU. Exemple : up-qemu-vm.sh. Je me suis dit qu'il serait élégant de lancer des VM QEMU de la même manière que Podman Quadlets.
Je n'ai pas réussi à résister à cette idée. Le 10 décembre au soir, je me suis dit que j'allais consacrer une petite heure à tester cette idée via du vibe coding avec Aider et Claude Sonnet 4.5.
Cette heure s'est transformée en 12h de session non-stop. J'ai réussi à publier une première version de qemu-compose, mais je venais de rompre ma discipline : je n'avais toujours pas écrit ma note sur Podman Quadlets.
Depuis, je n'ai pas réussi à retrouver ma discipline. Je suis tombé dans une spirale de papillonnage qui a duré deux mois 🙈.
En rédigeant cette note, j'ai essayé de comprendre pourquoi j'avais dérapé.
Je pense que c'était la combinaison de plusieurs facteurs :
- Le déclencheur : Ma première expérience réelle de vibe coding sur un projet complet. Cette expérience m'a tellement excité et en même temps tellement perturbé que j'ai perdu la motivation de rédiger ma note sur Podman Quadlets.
- La cascade : Une fois le premier écart fait, l'effet "What the hell" s'est enclenché : mon cerveau a rationalisé la continuation du comportement déviant par un "de toute façon, c'est déjà foutu, autant continuer".
- Le contexte : J'étais dans une période de stress et de frustration. L'illusion de toute-puissance qu'offrent les derniers modèles 4.5 d'Anthropic — obtenir des résultats rapides — m'a poussé dans une fuite en avant, un échappatoire pour combler mes frustrations du moment.
Depuis 2 ans, j'utilise trois garde-fous (circuit breakers) pour m'empêcher de démarrer un nouveau projet sans avoir terminé le précédent — autrement dit, pour éviter de papillonner et de survoler les sujets :
- Je tracke toutes mes activités via Toggl. Quand je démarre une activité, je lance consciemment le chronomètre. Cette friction me force à nommer ce que je fais et à rester conscient du temps que j'y consacre. C'est un premier filtre contre les distractions impulsives.
- Tous les matins, je rédige mes todo lists pro et perso dans Obsidian. L'élément clé est une section "Je ne veux pas faire" où je liste explicitement les tâches tentantes mais hors priorité. C'est mon exutoire pour les idées qui me donnent envie sans pour autant y céder.
- La publication de notes sur notes.sklein.xyz me force à définir ma "Definition of Done". Une itération (un sujet) n'est terminée que quand la note est publiée.
En analysant mes notes, je constate que j'ai progressivement abandonné la rédaction de mes todo lists quotidiennes à partir du 5 décembre — soit 5 jours avant mon dérapage sur qemu-compose.
Je pense que ce n'est pas un hasard.
#JaiDécidé de reprendre cette routine dès demain. C'est mon garde-fou le plus important.
Voici les sujets en vrac que j'ai survolés pendant ces 2 derniers mois — tous sans note de synthèse publiée :
- Réimplémentation complète de ma configuration chezmoi (inachevée)
- Développement de
gnome-settings-import-export
- Développement de
- Étude de timeshift et snapper
- Installation et configuration de netbird sur mes NUC
- Tentative d'installation de Kodi sur un de mes NUC (inachevée)
- Nouvelle configuration Neovim from scratch basée sur LazyVim (inachevée) :
lazyvim-playground - Migration de Fugitive vers Neogit
- Développement et publication du plugin
neo-tree-session.nvim - Étude puis abandon d'une migration Alacritty + tmux → wezterm (branche WIP)
- Étude puis abandon d'une migration Alacritty + tmux → kitty
- Étude d'une migration Alacritty → foot + tmux (en cours)
- Contribution au projet foot avec 2 Merge Requests :
- Test d'avante.nvim, notamment Avante Zen Mode — piste abandonnée
- Migration de Aider vers OpenCode
- Adoption de Jujutsu à la place de Git — utilisation quotidienne depuis plus d'un mois, progression continue mais pas encore fluide
Bilan : 13 explorations, 2 contributions open source, 1 plugin publié, 0 note de synthèse 😔.
En publiant cette note, je souhaite casser cet effet "What the hell".
Je vais sans doute accepter de ne pas publier de notes sur les sujets que j'ai abandonnés. Par contre, je souhaite à l'avenir publier des notes au sujet de :
Journal du lundi 12 janvier 2026 à 09:36
Il y a exactement 1 an, j'ai publié cette note pour citer ce message de Salvatore Sanfilippo, créateur de Redis :
About "people still thinking LLMs are quite useless", I still believe that the problem is that most people are exposed to ChatGPT 4o that at this point for my use case (programming / design partner) is basically a useless toy. And I guess that in tech many folks try LLMs for the same use cases. Try Claude Sonnet 3.5 (not Haiku!) and tell me if, while still flawed, is not helpful.
Aujourd'hui, je viens de lire son nouveau billet : Don't fall into the anti-AI hype (1106 commentaires sur HackerNews, 217 commentaires sur Lobsters).
Ces observations rejoignent ce que je constate avec OpenCode et les modèles Claude Sonnet 4.5 ou Claude Opus 4.5. Il me semble que "coder à la main" pourrait devenir un jeu, comme faire des sudoku ou jouer à des jeux vidéo. Pour le moment, je n'ai aucune idée de l'impact que cela aura sur mes capacités cognitives. J'ai l'impression que mes compétences pourraient décliner.
En fait, j'ai très peur de ne plus faire d'efforts de compréhension et qu'après quelques mois ou années, je devienne de plus en plus bête en déléguant systématiquement la réflexion à l'IA.
Voici cet article, traduit en français avec Claude Sonnet 4.5 :
Ne tombez pas dans le battage anti-IA
J'adore écrire du logiciel, ligne par ligne. On pourrait dire que ma carrière a été un effort continu pour créer des logiciels bien écrits, minimaux, où la touche humaine était la caractéristique fondamentale. J'espère également une société où les derniers ne sont pas oubliés. De plus, je ne souhaite pas que l'IA réussisse économiquement, je me fiche que le système économique actuel soit subverti (je pourrais être très heureux, honnêtement, si cela va dans la direction d'une redistribution massive de la richesse). Mais, je ne me respecterais pas moi-même et mon intelligence si mon idée du logiciel et de la société devait altérer ma vision : les faits sont les faits, et l'IA va changer la programmation pour toujours.
En 2020, j'ai quitté mon emploi pour écrire un roman sur l'IA, le revenu de base universel, une société qui s'adaptait à l'automatisation du travail en faisant face à de nombreux défis. À la toute fin de 2024, j'ai ouvert une chaîne YouTube axée sur l'IA, son utilisation dans les tâches de codage, ses effets sociaux et économiques potentiels. Mais bien que j'aie reconnu très tôt ce qui allait se passer, je pensais que nous avions plus de temps avant que la programmation ne soit complètement remodelée, au moins quelques années. Je ne crois plus que ce soit le cas. Récemment, les LLM de pointe sont capables de compléter de grandes sous-tâches ou des projets de taille moyenne seuls, presque sans assistance, avec un bon ensemble d'indices sur ce que devrait être le résultat final. Le degré de succès que vous obtiendrez est lié au type de programmation que vous faites (plus c'est isolé et textuellement représentable, mieux c'est : la programmation système est particulièrement adaptée), et à votre capacité à créer une représentation mentale du problème à communiquer au LLM. Mais, en général, il est maintenant clair que pour la plupart des projets, écrire le code soi-même n'a plus de sens, si ce n'est pour s'amuser.
Au cours de la semaine dernière, simplement en promptant, et en inspectant le code pour fournir des conseils de temps en temps, en quelques heures j'ai accompli les quatre tâches suivantes, en heures au lieu de semaines :
J'ai modifié ma bibliothèque linenoise pour supporter l'UTF-8, et créé un framework pour tester l'édition de ligne qui utilise un terminal émulé capable de rapporter ce qui est affiché dans chaque cellule de caractère. Quelque chose que j'ai toujours voulu faire, mais il était difficile de justifier le travail nécessaire juste pour tester un projet personnel. Mais si vous pouvez simplement décrire votre idée, et qu'elle se matérialise dans le code, les choses sont très différentes.
J'ai corrigé des échecs transitoires dans le test de Redis. C'est un travail très ennuyeux, des problèmes liés au timing, des conditions de deadlock TCP, etc. Claude Code a itéré pendant tout le temps nécessaire pour le reproduire, a inspecté l'état des processus pour comprendre ce qui se passait, et a corrigé les bugs.
Hier, je voulais une bibliothèque C pure capable de faire l'inférence de modèles d'embedding de type BERT. Claude Code l'a créée en 5 minutes. Même sortie et même vitesse (15% plus lent) que PyTorch. 700 lignes de code. Un outil Python pour convertir le modèle GTE-small.
Au cours des dernières semaines, j'ai effectué des modifications des mécanismes internes de Redis Streams. J'avais un document de conception pour le travail que j'ai fait. J'ai essayé de le donner à Claude Code et il a reproduit mon travail en, genre, 20 minutes ou moins (principalement parce que je suis lent à vérifier et à autoriser l'exécution des commandes nécessaires).
Il est tout simplement impossible de ne pas voir la réalité de ce qui se passe. Écrire du code n'est plus nécessaire pour la plupart. Il est maintenant beaucoup plus intéressant de comprendre quoi faire, et comment le faire (et, à propos de cette deuxième partie, les LLM sont aussi d'excellents partenaires). Peu importe si les entreprises d'IA ne pourront pas récupérer leur argent et que le marché boursier s'effondrera. Tout cela est sans importance, à long terme. Peu importe si tel ou tel PDG d'une licorne vous dit quelque chose de rebutant, ou d'absurde. La programmation a changé pour toujours, de toute façon.
Comment je me sens, à propos de tout le code que j'ai écrit qui a été ingéré par les LLM ? Je suis ravi d'en faire partie, parce que je vois cela comme une continuation de ce que j'ai essayé de faire toute ma vie : démocratiser le code, les systèmes, la connaissance. Les LLM vont nous aider à écrire de meilleurs logiciels, plus rapidement, et permettront aux petites équipes d'avoir une chance de rivaliser avec les plus grandes entreprises. La même chose que les logiciels open source ont fait dans les années 90.
Cependant, cette technologie est beaucoup trop importante pour être entre les mains de quelques entreprises. Pour l'instant, vous pouvez faire le pré-entraînement mieux ou pas, vous pouvez faire l'apprentissage par renforcement de manière beaucoup plus efficace que d'autres, mais les modèles ouverts, en particulier ceux produits en Chine, continuent de rivaliser (même s'ils sont en retard) avec les modèles de pointe des laboratoires fermés. Il y a une démocratisation suffisante de l'IA, jusqu'à présent, même si elle est imparfaite. Mais : il n'est absolument pas évident qu'il en sera ainsi pour toujours. J'ai peur de la centralisation. En même temps, je crois que les réseaux de neurones, à l'échelle, sont simplement capables de faire des choses incroyables, et qu'il n'y a pas assez de "magie" dans l'IA de pointe actuelle pour que les autres laboratoires et équipes ne rattrapent pas leur retard (sinon il serait très difficile d'expliquer, par exemple, pourquoi OpenAI, Anthropic et Google sont si proches dans leurs résultats, depuis des années maintenant).
En tant que programmeur, je veux écrire plus d'open source que jamais, maintenant. Je veux améliorer certains de mes dépôts abandonnés pour des raisons de temps. Je veux appliquer l'IA à mon workflow Redis. Améliorer l'implémentation des Vector Sets et ensuite d'autres structures de données, comme je le fais avec Streams maintenant.
Mais je m'inquiète pour les gens qui vont être licenciés. Il n'est pas clair quelle sera la dynamique en jeu : les entreprises vont-elles essayer d'avoir plus de personnes, et de construire plus ? Ou vont-elles essayer de réduire les coûts salariaux, en ayant moins de programmeurs qui sont meilleurs au prompting ? Et, il y a d'autres secteurs où les humains deviendront complètement remplaçables, je le crains.
Quelle est la solution sociale, alors ? L'innovation ne peut pas être annulée après tout. Je crois que nous devrions voter pour des gouvernements qui reconnaissent ce qui se passe, et qui sont prêts à soutenir ceux qui resteront sans emploi. Et, plus les gens seront licenciés, plus il y aura de pression politique pour voter pour ceux qui garantiront un certain degré de protection. Mais j'attends également avec impatience le bien que l'IA pourrait apporter : de nouveaux progrès en science, qui pourraient aider à réduire la souffrance de la condition humaine, qui n'est pas toujours heureuse.
Quoi qu'il en soit, revenons à la programmation. J'ai une seule suggestion pour vous, mon ami. Quoi que vous croyiez sur ce qui devrait être la Bonne Chose, vous ne pouvez pas la contrôler en refusant ce qui se passe actuellement. Éviter l'IA ne va pas vous aider, vous ou votre carrière. Pensez-y. Testez ces nouveaux outils, avec soin, avec des semaines de travail, pas dans un test de cinq minutes où vous ne pouvez que renforcer vos propres convictions. Trouvez un moyen de vous multiplier, et si cela ne fonctionne pas pour vous, réessayez tous les quelques mois.
Oui, peut-être pensez-vous que vous avez travaillé si dur pour apprendre à coder, et maintenant les machines le font pour vous. Mais quel était le feu en vous, quand vous codiez jusqu'à la nuit pour voir votre projet fonctionner ? C'était construire. Et maintenant vous pouvez construire plus et mieux, si vous trouvez votre façon d'utiliser l'IA efficacement. Le plaisir est toujours là, intact.
Via Claude Sonnet 4.5, j'ai découvert l'existance des projets croc et Magic Wormhole.
Ces deux projets permettent de partager des fichiers entre deux machines.
Voici un tableau comparatif :
Caractéristique Magic Wormhole croc Langage Python Go (plus rapide) Reprise transfert ❌ ✅ Multi-fichiers ❌ (un par un) ✅ Vitesse Bon Meilleur Maturité Plus ancien, stable Plus récent, actif Stdin/stdout ✅ Excellent ✅ Bon
J'ai décidé de tester croc.
Sur ma workstation Fedora, j'ai lancé :
$ sudo dnf install -y croc
$ croc --version
croc version v9.6.4-1fce28e
$ croc send --text "Foobar"
Sending 'text' (6 B)
Code is: 8834-lady-protect-senator
On the other computer run
croc 8834-lady-protect-senator
Sur une seconde machine :
$ croc --yes 8834-lady-protect-senator
Receiving text message (6 B)
Receiving (<-192.168.1.108:9009)
Foobar
Ça fonctionne bien, je garde cet outil dans ma boîte à outils 🙂.
Script d'analyse des coûts Aider à partir de l'historique
J'ai cherché une fonctionnalité pour calculer le coût total de l'utilisation d'Aider sur un projet. Je n'ai rien trouvé dans la documentation ni dans les issues du projet Aider.
Je sais qu'Aider enregistre toutes les informations de session dans .aider.chat.history.md.
Ce fichier contient des lignes du type : "Tokens: 49k sent, 1.9k received. Cost: $0.17 message, $1.68 session".
À partir de ces informations, j'ai généré avec Claude Sonnet 4.5 le script Python aider_cost_analyzer.py.
Installation sous Fedora :
$ mkdir -p ~/.local/bin
$ curl -o ~/.local/bin/aider_cost_analyzer.py https://gist.githubusercontent.com/stephane-klein/3b3808c1b03b7e6ddfc4b22b69fdf776/raw/4262faec0cb2f468ea6b6d8751339b8e8497f005/aider_cost_analyzer.py
$ chmod +x ~/.local/bin/aider_cost_analyzer.py
Exemple d'utilisation :
$ aider_cost_analyzer.py .
Analyzing 1 history file(s) in '.':
.aider.chat.history.md:
Messages: 30
Tokens sent: 639,200 | received: 65,613
Cost: $1.86
============================================================
Total tokens sent: 639,200
Total tokens received: 65,613
Total cost: $1.86
J'ai posté l'issue suivante dans le repository aider-ce : "Calculate cumulative token usage and cost across all Aider sessions".
net-tools est déprécié, je dois remplacer "lsof -i" par "ss -tlnp"
J'utilise habituellement lsof -i | grep "8080" pour identifier le processus qui écoute sur le port 8080.
Comme je le mentionnais dans 2025-07-04_1614, j'ai appris net-tools au début des années 2000 et j'ai gardé cette habitude depuis.
D'après Claude Sonnet 4.5, iproute2 est devenu le standard dans Debian, Ubuntu et Fedora vers 2013-2015. net-tools a été supprimé de l'installation par défaut entre 2017 et 2018.
lsof (pour LiSt Open Files) interroge /proc pour récupérer les informations. Cette implémentation, comme tous les outils net-tools, est ancienne et n'utilise pas l'API moderne Netlink.
En 2025, la méthode recommandée pour identifier les processus écoutant des ports est cette commande iproute2 (code source) :
$ ss -tlnp | grep 8080
-t: TCP sockets-l: Listening sockets uniquement-n: Affichage numérique (pas de résolution DNS)-p: Affiche les processus
J'ai écrit cette note et bridge-utils est déprécié, je dois remplacer "brctl" par "ip link" pour m'aider à adopter les commandes modernes iproute2.
Pour apprendre cette nouvelle commande, j'ai ajouté la carte-mémoire suivante dans Anki :
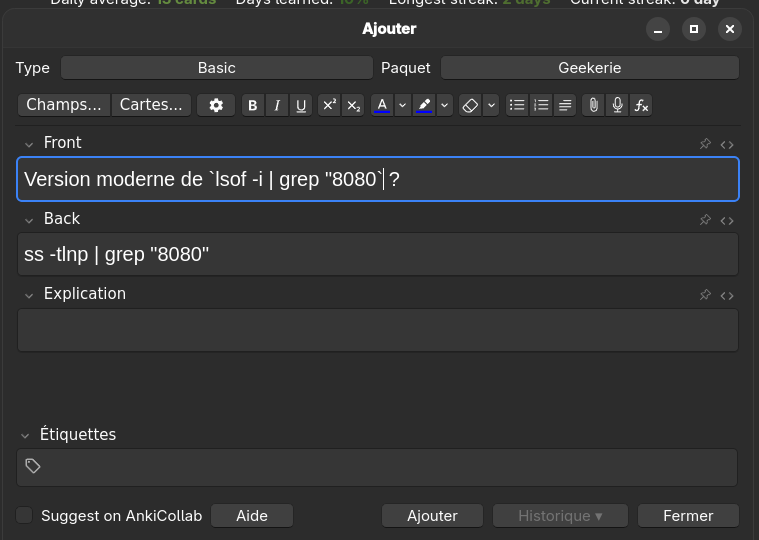
J'ai découvert class-variance-authority et tailwinds-variants
Jusqu'à présent, pour la gestion conditionnelle des classes CSS dans mes projets ReactJS ou Svelte, j'utilisais clsx.
Pour Svelte en particulier, j'utilise souvent directement le mécanisme conditionnel natif de l'attribut "class" du framework.
Aujourd'hui, dans un projet professionnel ReactJS, #JaiDécouvert la librairie conditionnelle class-variance-authority.
Cette librairie existe depuis debut 2022 et voici un exemple d'utilisation de class-variance-authority :
<script>
import { cva } from 'class-variance-authority';
const button = cva(
'font-semibold rounded', // équivalent au paramètre `base:` utlisé par tailwind-variants
{
variants: {
intent: {
primary: 'bg-blue-500 text-white hover:bg-blue-600',
secondary: 'bg-gray-200 text-gray-900 hover:bg-gray-300'
},
size: {
sm: 'px-3 py-1 text-sm',
md: 'px-4 py-2 text-base',
lg: 'px-6 py-3 text-lg'
}
},
compoundVariants: [
{
intent: 'primary',
size: 'lg',
class: 'uppercase tracking-wide' // <= appliqué seulement si intent="primary" et size="lg"
}
],
defaultVariants: {
intent: 'primary',
size: 'md'
}
}
);
export let intent = 'primary';
export let size = 'md';
</script>
<button class={button({ intent, size })}>
<slot />
</button>
Je trouve cette approche plus élégante que clsx pour des besoins complexes, comme la création d'un design system.
Dans la même famille de librairie, il existe aussi tailwind-merge que j'avais déjà identifié mais sans avoir jamais pris le temps d'étudier. Ses fonctionnalités sont très simples et minimalistes :
Merge Tailwind CSS classes without style conflicts
Claude Sonnet 4.5 m'a fait découvrir tailwind-variants, une alternative à class-variance-authority. Cette lib est spécifique à Tailwind CSS mais offre de meilleures performances et des fonctionnalités supplémentaires par rapport à class-variance-authority.
Le projet a été créé début 2023, soit environ 1 an après class-variance-authority.
Voici un tableau comparant les fonctionnalités de tailwind-variants et class-variance-authority :
La dernière section de la page Tailwind Variants - Comparison explique l'historique de la lib avec class-variance-authority et les raisons qui ont motivé sa création.
Après quelques difficultés, je pense avoir saisi l'intérêt de la fonctionnalité "slots", disponible dans tailwind-variants mais absente de class-variance-authority.
Si un jour je dois créer des composants de design system avancés dans un projet ReactJS ou Svelte, je pense que j'utiliserai tailwind-variants.
J'ai découvert Adminer, alternative à PhpMyAdmin et je me suis intéressé à OPCache
En travaillant sur un playground d'étude de Podman Quadlets, dans le README.md de l'image Docker mariadb, #JaiDécouvert le projet Adminer (https://www.adminer.org) qui semble être l'équivalent de PhpMyAdmin, mais sous la forme d'un fichier unique.
Je découvre aussi que contrairement à PhpMyAdmin, Adminer n'est pas limité à Mysql / MariaDB, il supporte aussi PostgreSQL.
En regardant le dépôt GitHub d'Adminer, je découvre que le gros fichier PHP de 496 kB est le résultat de la concaténation de nombreux fichiers php.
Ça me rassure, parce que je me demandais comment l'édition d'un fichier unique de cette taille pouvait être humainement gérable.
Je trouve astucieux ce mode de déploiement d'un projet PHP sous forme d'un seul fichier qui me fait penser à la méthode Golang. Cependant, je me pose des questions sur la performance de cette technique étant donné que PHP fonctionne en mode process-per request (CGI), ce qui signifie que ce gros fichier PHP est interprété à chaque action sur la page 🤔.
En creusant un peu le sujet avec Claude Sonnet 4.5, je découvre que depuis la version 5.5 de PHP, OPCache améliore significativement la vitesse des requêtes PHP, sans pour autant atteindre celle de Golang, NodeJS, Python ou Ruby qui utilisent des serveurs HTTP intégrés. La consommation mémoire reste supérieure dans des conditions d'implémentation comparables.
Avec OPCache, Adminer semble rester performant malgré l'utilisation d'un fichier unique.
Script qui permet de transformer automatiquement du texte en anglais en fichier audio
J'ai généré avec Claude Sonnet 4.5 le script Python text_to_audio.py. Il me permet de transformer automatiquement du texte en anglais en fichier audio mp3.
J'intègre ensuite ces fichiers dans mes carte-mémoire Anki pour travailler mon anglais.
Installation sous Fedora :
$ mkdir -p ~/.local/bin
$ curl -o ~/.local/bin/text_to_audio.py https://gist.githubusercontent.com/stephane-klein/1406e746f0253956062d4adff7a692bd/raw/8571cdd91cae8ebcd208435daacf431cfc1cd353/text_to_audio.py
$ chmod +x ~/.local/bin/text_to_audio.py
Exemple d'utilisation :
$ text_to_audio.py "Reinforcement Learning from Human Feedback"
Downloading audio for: 'Reinforcement Learning from Human Feedback'
Language: en-GB
URL: https://translate.google.com/translate_tts?ie=UTF-8&tl=en-GB&client=tw-ob&q=Reinforcement+Learning+from+Human+Feedback
Saving to: /home/stephane/english_audio/2025-12-01_Reinforcement_Learning_from_Human_Feedback.mp3
✓ Successfully downloaded to '/home/stephane/english_audio/2025-12-01_Reinforcement_Learning_from_Human_Feedback.mp3'
File size: 28224 bytes
J'utilise actuellement un endpoint HTTP de Google Translator pour générer les fichiers audio, en attendant de trouver une alternative plus open source / communautaire.
Journal du vendredi 21 novembre 2025 à 14:32
Via Claude Sonnet 4.5, #JaiDécouvert le projet Massive Text Embedding Benchmark qui compare les embeddings Models.
Voici le site de documentation, son dépôt GitHub, et son leaderboard qui liste actuellement 319 models, dont 180 supportant le français.
Setup Fedora CoreOS avec LUKS et Tang
Il y a quelques jours, dans ma note "Setup Fedora CoreOS avec LUKS et TPM", je disais :
Une solution pour traiter ce point faible est d'utiliser un pin éloigné physiquement du serveur qui l'utilise.
Le framework Clevis utilise le terme "pins" pour désigner les différents méthodes de déverrouillage d'un volume LUKS.
Origine du mot "pin" ?
Claude Sonnet 4.5 m'a expliqué que le terme "pin", qui se traduit par "goupille" en français, désigne la pièce mécanique qui bloque l'ouverture d'un cadenat.
Par exemple, dans un contexte self hosting dans un homelab, je peux héberger physiquement un serveur dans mon logement et le connecter à un pin sur un serveur Scaleway ou sur un serveur dans le homelab d'un ami.
Les pins distants, accessibles via réseau, sont appelés serveurs Network-Bound Disk Encryption.
Si le serveur Network-Bound Disk Encryption est configuré pour répondre uniquement aux requêtes provenant de l'IP de mon réseau homelab, en cas de vol du serveur, le voleur ne pourra pas récupérer le secret permettant de déchiffrer le volume LUKS.
Dans le playground install-coreos-iso-on-qemu-with-luks-and-tang, j'ai testé avec succès le déverrouillage d'un volume LUKS avec un serveur Network-Bound Disk Encryption nommé tang.
Pour être précis, dans la configuration de ce playground, deux pins sont obligatoires pour déverrouiller automatiquement le volume : un pin tang et un pin TPM2. Le nombre minimum de pins requis pour le déverrouillage est défini par le paramètre threshold.
clevis, qui permet de configurer les pins et de gérer la récupération de la passphrase à partir des pins, utilise l'algorithme Shamir's secret sharing (SSS) pour répartir le secret à plusieurs endroits.
Voici quelques scénarios de conditions de déverrouillage que clevis permet de configurer grâce à SSS :
- TPM2 ou Tang serveur 1
- TPM2 et Tang serveur 1
- Tang serveur 1 ou Tang serveur 2
- 2 parmi Tang serveur 1, Tang serveur 2, Tang serveur 3
- ...
Si les conditions ne sont pas remplies, systemd-ask-password demande à l'utilisateur de saisir sa passphrase au clavier.
Je n'ai pas trouvé d'image docker officielle de tang. Toutefois, j'ai trouvé ici l'image non officielle padhihomelab/tang (son dépôt GitHub : https://github.com/padhi-homelab/docker_tang).
Dans mon playground, je l'ai déployé dans ce docker-compose.yml.
J'ai trouvé la configuration butane de tang simple à définir (lien vers le fichier) :
luks:
- name: var
device: /dev/disk/by-partlabel/var
wipe_volume: true
key_file:
inline: password
clevis:
tpm2: true
tang:
- url: "http://10.0.2.2:1234"
# $ docker compose exec tang jose jwk thp -i /db/pLWwUuLhqqFb-Mgf5iVkwuV4BehG9vzd2SXGMyGroNw.jwk
# pLWwUuLhqqFb-Mgf5iVkwuV4BehG9vzd2SXGMyGroNw
thumbprint: dx9dNzgs-DeXg0SCBQW5rb7WQkSIN1B8MIgcO6WxJfI
threshold: 2 # TMP2 + Tang (or passphrase keyboard input)
La seule complexité que j'ai rencontrée est la méthode pour récupérer le paramètre thumbprint de l'instance tang.
Voici la méthode que j'ai utilisée :
$ docker compose exec tang jose jwk thp -i /db/pLWwUuLhqqFb-Mgf5iVkwuV4BehG9vzd2SXGMyGroNw.jwk
pLWwUuLhqqFb-Mgf5iVkwuV4BehG9vzd2SXGMyGroNw
Autre difficulté, il faut ajouter les arguments kernel suivants pour activer l'accès réseau dès le début du process de boot afin de permettre à clevis d'accéder au serveur tang :
variant: fcos
version: 1.6.0
kernel_arguments:
should_exist:
- ip=dhcp
- rd.neednet=1
J'ai intégré au README.md du playground une section nommée "How to switch from 2 required ping to 1 or the opposite?", pour documenter comment modifier à chaud la configuration clevis.
Par exemple pour changer de serveur tang ou modifier le nombre de pins nécessaires pour déverrouiller la partition chiffrée.
Il est conseillé d'activer le pin TPM2 en complément de tang pour éviter ce type d'attaque décrit par Claude Sonnet 4.5 :
Imaginons un admin malveillant dans ton entreprise :
- Il a accès physique aux serveurs
- Il a accès au réseau (donc au serveur Tang)
- Il clone un disque pendant la nuit
- Il essaie de le monter sur sa propre machine pour extraire des données
Tang seul : ❌ Il réussit
TPM + Tang : ✅ Il échoue
À noter que l'instance tang ne contient pas la passphrase et ne voit jamais passer la passphrase via son API.
Voici les explications que m'a données Claude Sonnet 4.5 :
Tang ne stocke pas la passphrase secrète de chiffrement LUKS. C'est justement tout l'intérêt de cette solution !
Voici comment ça fonctionne :
Le principe de Tang + Clevis
- Génération de clé dérivée : Clevis (le client) contacte le serveur Tang et récupère sa clé publique
- Chiffrement avec la clé de Tang : Clevis utilise cette clé publique pour chiffrer la passphrase LUKS
- Stockage local : La passphrase chiffrée est stockée localement dans l'en-tête LUKS du disque (pas sur le serveur Tang)
- Déchiffrement au boot :
- La machine contacte Tang
- Tang utilise sa clé privée pour aider à déchiffrer
- La passphrase LUKS est reconstituée
- Le disque est déverrouillé
Ce que Tang sait et ne sait pas
- ❌ Tang ne connaît jamais votre passphrase LUKS
- ❌ Tang ne stocke rien concernant vos clés
- ✅ Tang fournit juste un service cryptographique (un oracle de déchiffrement)
- ✅ C'est un serveur sans état (stateless)
C'est du chiffrement asymétrique avec un mécanisme appelé "network-bound disk encryption" : le disque ne peut être déchiffré que si la machine peut contacter le serveur Tang sur le réseau.
Voici quelques ressources supplémentaires au sujet des techniques de déverrouillage automatique des volumes LUKS :